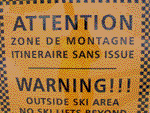Construit en 1980, ce petit télésiège permet d’accéder à 2476m d’altitude, le second point le plus haut du domaine skiable (les Grandes Platières étant à 2484m).
Situé juste au dessus de la télécabine de l’Aup de Véran, ce télésiège est au cœur du désert de Platé. De ce fait, l’enneigement doit être excellent pour une ouverture optimale (aucune piste desservie étant terrassé). Il faut atteindre environ 2 à 3m de neige pour une ouverture du secteur. C'est-à-dire que le télésiège ouvre rarement avant la mi février.
Pour plus de précision, voici la situation du télésiège dans le Grand Massif :

Zoom :

L’accès au télésiège se fait uniquement depuis la télécabine Aup de Véran ou depuis les Grandes Platières via la piste rouge Méphisto supérieur.
Le télésiège dessert 2 pistes ; une rouge nommé Fred ainsi qu’une noire nommé Agate, une piste qui porte bien son nom. C’est d’ailleurs la piste la plus difficile du Grand Massif, mais surtout la plus dangereuse. Une piste 100% lapiaz (rocher) ou se trouve des falaises et des gouffres. Voilà pourquoi un gros cumule de neige est important pour l’ouverture du télésiège.
Vue aérienne du télésiège et de ses pistes :
A noter une vue splendide au sommet du télésiège. Panorama sur toute la chaîne du Mont Blanc, ainsi que la vallée des Houches et du Montjoie.
Caractéristiques techniques :
- année de construction = 1980
- constructeur = Pomagalski
- altitude aval = 2170m
- altitude amont = 2476m
- dénivelée = 306m
- longueur développée = 1095m
- longueur horizontale = 1031m
- pente moyenne = 30%
- pente maximale = 56%
- sens de la montée = droite
- débit à la montée = 900p/h
- débit à la descente = 0p/h
- vitesse = 2,31m/s
- situation motrice = aval
- puissance du moteur électrique principal = 129kW
- type de moteur électrique = asynchrone
- type de moteur de secours = thermique 6 cylindres turbo
- situation tension = aval
- type de tension = hydraulique
- nombre de vérins = 2
- tension nominale = 25021daN
- pression nominale = 113bar
- cadencement = 8,2s
- survol maximal = 21m
- portée maximale = 200m
- nombre de pylônes = 10
- nombre de pylônes support = 7
- nombre de pylônes compression = 2
- nombre de pylônes support compression = 1
- diamètre des galets = 420mm
- diamètre poulie motrice = 3800mm
- diamètre poulie retour = 3550mm
- nombre de véhicules = 119+1
- type de véhicules = «goûte d’eau»
- capacité d’un véhicules = 2 places
- masse à vide d’un véhicule = 74kg
- diamètre du câble = 33,5mm
- fabriquant du câble = Trefileurope
- résistance à la rupture = 81360daN
La gare aval est d’un type étonnant, elle est motrice tension enterré. Rare sont les télésièges Poma de ce genre.
Quelques exemples ; TSF3 Moulins aux Carroz et les anciens TSF3 Chaux Fleurie (Avoriaz) et Varoche (Praz sur Arly) hors exploitation en ce jour.
L’avantage de ces gares est d’avoir un impact visuel très faible, ainsi qu’une maintenance au sec.
Voici quelques photos de la gare aval :
Ci-dessus, la masse noire est la couverture du lorry qui se trouve en contre bas (explication par la suite du reportage).
Présentation du pupitre en gare aval.
En haut, la commande du moteur thermique, en dessous les voyants et à leurs droites, la vitesse du câble :
Ici, l’ampèremètre et le voltmètre du moteur électrique et du réseau, le groupe de sécurité de la ligne, les compteurs horaires et skieurs ainsi que les boutons :
Pour en revenir à la caractéristique de la gare aval, elle est donc motrice tension enterrée.
Tout le groupe moteurs, réducteur, poulie motrice est fixé au lorry qui est lui-même posé au sol sur des roues métalliques. Lorry qui se déplace à l’aide de deux vérins.
Le schéma ci-dessous est très représentatif :

Toute la partie grise est la partie mobile de la gare, c'est-à-dire le lorry.
Le télésiège fonctionne donc de la façon suivante.
Un moteur électrique entraîne le réducteur via des courroies. A la sortie de l’arbre moteur se trouve un frein de parking (utilisation manuel). A l’entrée du réducteur se trouve le frein de service, permettant un arrêt frein 1. Depuis le réducteur, un arbre vertical permet la rotation de la poulie motrice.
Sur la poulie motrice, 2 freins de poulie sont présents (frein 2).
En marche de secours (moteur électrique hors service), c’est le moteur thermique (turbo diesel) qui permet la rotation de la poulie motrice. Avant tout, il faut accouplé le moteur thermique avec le réducteur manuellement. A noter qu’à la sortie du thermique se trouve un petit réducteur. En marche de secours, il y a donc 2 réducteurs en fonction.
Les photos qui suivent sont plus explicatives.
Vue générale dans la gare :
Le moteur électrique est en noir, difficile de le voir. Devant se trouve l’arbre moteur (désolé pour la prise de vue) :
Le frein de parking :
Le réducteur :
Le frein de service et l’accouplement électrique/thermique :
Le second réducteur, appartenant au thermique :

Le moteur thermique :
Les batteries permettant le démarrage du thermique ainsi que le réservoir de diesel
Le groupe hydraulique pour les freins :
Armoire électrique :
La centrale hydraulique pour les vérins de tension :
L’un des deux vérins :
Le lorry, monté sur roues métalliques :
Revenons à l’air, avec ici la poulie ainsi que l’arbre moteur :
Les deux freins de poulie :
L’embarquement sur les sièges ne se fait pas face à la poulie (comme c’est le cas pour la plupart des télésièges). L’embarquement se fait en ligne, juste avant le pylône 1 (voir les photos au début du reportage).
La ligne comporte 10 pylônes, donc 7 supports, 2 compressions et 1 support/compression.
Le pylône 1 :
Vue générale de la ligne :
Une pince :
Début de la montée :
Vue générale de la ligne :
Le pylône 2 :
Portée entre les pylônes 2 et 3 :
Le pylône 3 :
Portée entre les pylônes 3 et 4 :
Le pylône 4 :
Portée entre les pylônes 4 et 5 :
Le pylône 5 :
Le pylône 6 :
Le pylône 7 :
Le pylône 8 :
Partie haute de la ligne :
Portée entre les pylônes 8 et 9 :
Vue générale de la ligne :
Les pylônes 9 et 10 :
Partie haute de la ligne :
Entrée en gare amont :
Le débarquement :
Divers vues de la gare amont :
Vue depuis la Tête des Lindars avec au premier plan la gare amont, puis les Grandes Platières ainsi que le Mont Buet :
Fin du reportage.

 Aide
Aide